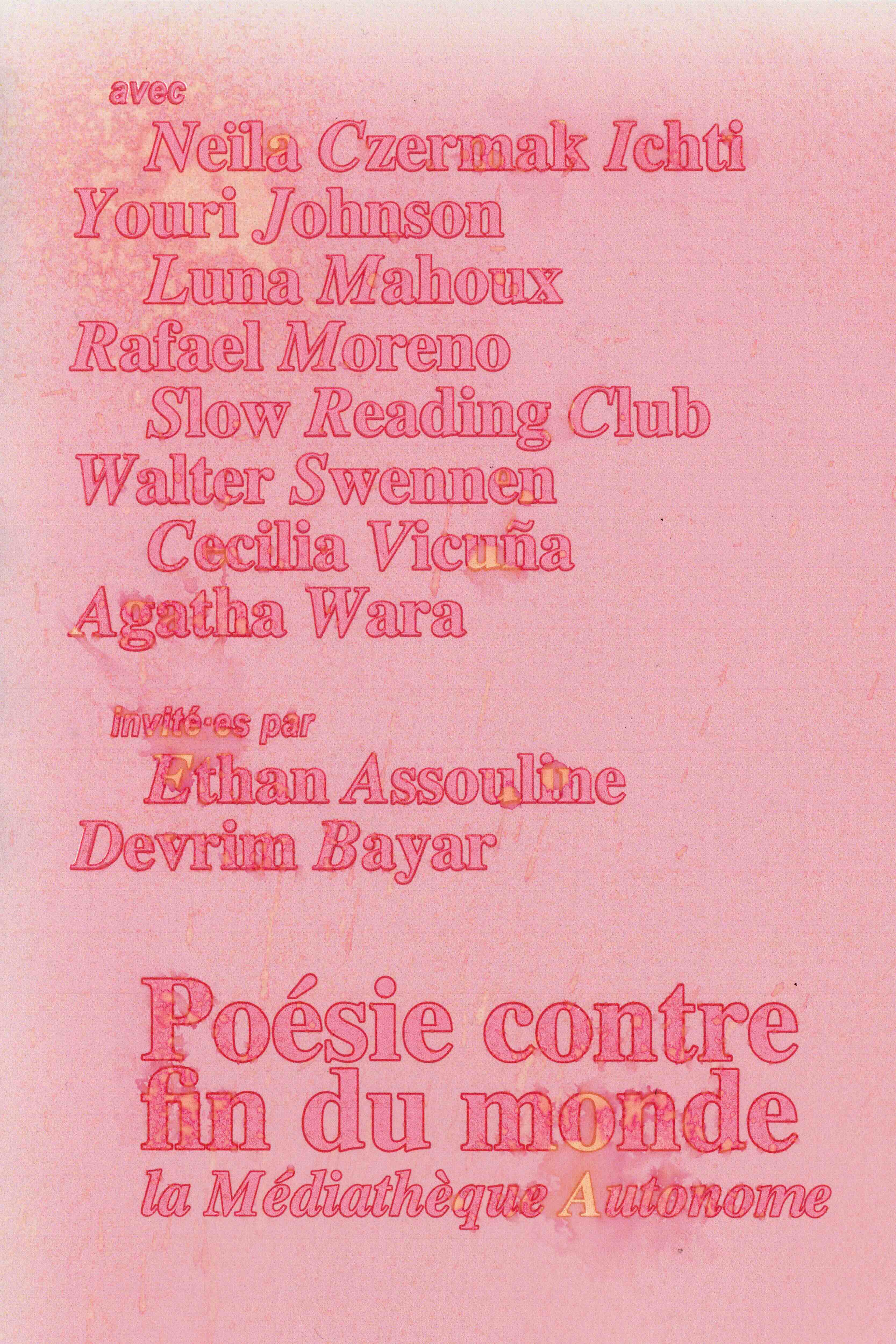14/12/2020
Ymane Fakhir manifeste un intérêt récurrent pour l’identité culturelle, la mémoire familiale et les intrications sociales, comme la place de la femme ou la double culture. Dans son travail, elle pratique des enquêtes au long cours. Elle a mené une recherche à la Cité La Castellane, un ghetto paupérisé de 4 500 habitants où elle s’est heurtée à des murs visibles et invisibles. Le résultat de ce travail a été restitué dans Manifesta.13, dans le volet « Traits d’Unions » sous la forme d’une lecture performée au Conservatoire, de Marseille intitulée « Le gouffre du léopard », et dans le volet « Parallèles du Sud », avec l’exposition personnelle « As We Go Along ».
Ymane Fakhir ne nomme jamais la cité. Elle parle d’une île. Pour se représenter une île, « il faut penser la mer par le dessous ». C’est ainsi vers la partie immergée du projet que mène cette interview.
Bénédicte Chevallier : Le travail que tu as présenté cet automne est issu d’une recherche entamée en 2017. Il y a eu de nombreuses impasses. Qu’est-ce qui t’a permis d’avancer malgré tout ? Comment as-tu conservé ta détermination ?
Ymane Fakhir : Il s’agit avant tout de rétablir la confiance. J’ai essayé de taper à toutes les portes mais en vain.
La plupart des femmes sont confrontées au trafic, elles vivent dans la peur pour leurs enfants, elles ont peur de l’image que la cité renvoie, et elles redoutent une infiltration. C’est donc la persévérance qui a fini par payer. C’est toujours une question de temps. Car quand il se passe quelque chose, c’est imprévisible. Il faut toujours être là, revenir. On ne sait pas comment ça arrive, c’est une sorte de grâce. Ça se passe comme par magie et puis ça disparaît. Ce jour-là, j’ai rencontré un groupe plus restreint. On a commencé à se dire les choses. Il a été question de plusieurs assassinats. C’est tellement violent, qu’on ne sait plus si c’est un film ou une réalité. On ne peut pas prévoir que ça va se dire ce jour-là. Ça ne se représentera jamais. C’est comme si on était dans le secret. C’est assez étrange.
B.C. : C’est comme un travail d’atelier… des matériaux qui tout à coup s’organisent et prennent un sens ?
Y.F. : Justement, je n’ai pas de pratique d’atelier, pas de savoir-faire manuel. Mon sujet, ma page blanche c’est le terrain de recherche. Mon atelier est blanc, dépouillé. Mais il est plein de notes, de sons, de traces de mes activités de recherche.
B.C. : Dans l’exposition, tu proposes au visiteur de créer une forme architecturale avec les modules d’une réplique de la cité Castellane. Pourquoi était-il important de permettre cette manipulation ?
Y.F. : C’est une manière de connecter les gens du centre-ville, où est présentée l’exposition, et la cité. Personne d’autre que les habitants n’a de raison d’aller là-bas. Et eux ne viennent pas facilement en ville, sauf à y travailler. Les formes géométriques qui reprennent le plan de la Castellane sont une invitation à l’imaginaire, tout le contraire des grands ensembles. Construire et déconstruire c’est une manière pour moi de voir ce qui va se passer, comme de prendre conscience de ce que l’on voit et ce que l’on occulte, consciemment ou pas.
B.C. : Dans le projet, tu ne parles jamais de la cité mais d’une île. Dans Le gouffre du léopard, un personnage évoque un phénomène de basculement à mesure que les habitants s’isolent de l’extérieur. Murs et immeubles se referment imperceptiblement et les prennent au piège. À l’heure, où nous sommes contraint·e·s de nous replier dans nos habitations, ce récit prend-il un nouveau relief ?
Y.F. : Les contraintes que nous vivons aujourd’hui trouvent un écho : nous entendons parler de foyers fragiles, de violences ou simplement de privation. Les habitants de l’île en subissent depuis des années : avec des moyens de transport limités qui les isolent de plus en plus, l’absence totale de structures à proximité. Ce qui est impératif et vital, c’est de s’approprier sa propre parole. Quand une îlienne dit que le paysage, est certes magique, mais qu’elle ne le voit plus, ce sont ses mots et le temps du récit apparaît comme un moyen de survie, un moyen d’exister.
B.C. : Le belvédère, titre de la vidéo, est la pièce centrale de l’exposition. Il s’agit d’une vue panoramique sur une rade et ses îles, balayée par un mouvement de caméra régulier, interrompu par un carrousel d’images fixes, des détails de ce paysage. Nous venons de la mer mais nous vivons sur terre. L’île est-elle l’entre-deux ?
Y.F. : L’île est un symbole. Elle est avant tout un point d’ancrage et rêve d’habitation. Tout le monde peut avoir son île. Elle fonctionne comme un miroir entre cet espace inconnu qu’est la mer et un espace connu la terre. Il y a deux motivations à l’exil : celle d’aller voir « derrière la colline » et celle de partir pour ses enfants, de leur offrir une vie meilleure, tout simplement. Avec l’idée d’un retour, toujours illusoire. Si l’île est ce que l’on espère trouver, elle peut être soit partout soit nulle part, introuvable. Tout dépend de l’attente de la personne qui accoste.
B.C : Encore un piège qui se referme, sur l’espoir cette fois ?
Y.F. : Il faut juste prendre tel quel l’endroit où on atterrit. Il y a trop de rêves. Tu ne peux pas dépendre de l’île. Pour les personnes que j’ai rencontrées, l’île était une terre promise, la solution à tous les problèmes. En premier lieu, il ne faut pas avoir honte, de sa langue, de sa culture. Il ne faut pas avoir peur de revendiquer ses droits.
B. C. : N’est-ce pas prendre conscience de ce qui caractérise notre identité pour trouver une agilité sociale ?
Y. F. : Effectivement, et dans mon travail, la même question revient sans cesse : comment pendant autant d’années les choses sont-elles restées les mêmes? Comment voir les choses autrement aujourd’hui ? Comment à travers de nouvelles représentations les faire bouger ? Comment construire le vivre ensemble avec nos différences ? Il faut consentir à voir ce qui change autour de soi et ne pas cultiver un paradis perdu, dans une forme de déni. Et surtout se remettre en mouvement, une fois atteint l’autre côté de la montagne. Ce qui est fatal, c’est l’immobilité, la fin de la curiosité. Elle ne doit pas s’arrêter quand on découvre se qui se cache derrière…
Interview de Ymane Fakhir réalisée par Bénédicte Chevallier, directrice de Mécènes du Sud Aix-Marseille
Décembre 2020